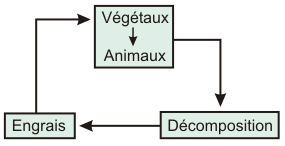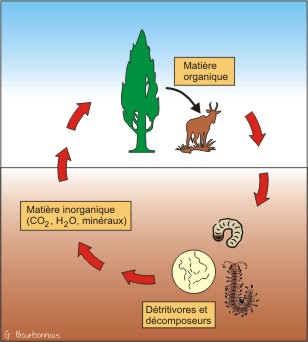|

|
La
nutrition chez les végétaux
3. Fertilité
du sol
|

|
3-
Fertilité des sols et agriculture
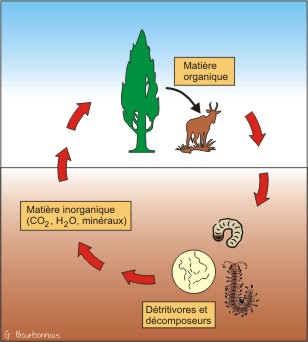
Dans
la nature, la matière est continuellement recyclée.
La matière organique qui retourne au sol est fragmentée
par les organismes qui y vivent (on les appelle les détritivores)
et finalement minéralisée (transformée en
matière inorganique) par les bactéries (qu'on appelle
décomposeurs). La fertilité du sol dépend
de ce recyclage. |
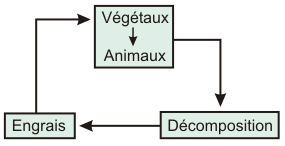 |
En
agriculture, le cycle est brisé. Une partie souvent importante
de la matière organique (végétaux qui ont
poussé) est exportée et non recyclée en engrais.
DONC
le sol s'appauvrit en engrais à chaque récolte.
DONC,
si on veut que le sol conserve sa fertilité, il faut rajouter
des fertilisants. On peut utiliser :
- Fumures
organiques
- Engrais
chimiques
Fumures
organiques
Les
fumures organiques, ce sont les déchets végétaux
et/ou animaux que l'on réintègre dans le sol. Surtout
si le fertilisant est riche en matières végétales,
ce mode de fertilisation est très bénéfique
pour la qualité des sols:
- Favorise
la vie des organismes du sol
Les fumures organiques servent de nourriture aux organismes
animaux du sol. Ils favorisent le maintien des chaînes
alimentaires complexes dans le sol.
- Maintient
la qualité physique du sol
Un bon sol doit contenir de l'humus. L'humus permet au sol de
demeurer friable, aéré, de retenir efficacement
l'eau entre les pluies (et donc de retenir aussi les engrais).
- Enrichit
le sol en nutriments. Évidemment la décomposition
de la matière organique fournit des éléments
nutritifs aux plantes. Ces éléments sont libérés
progressivement au fur et à mesure que la matière
se décompose.
Certains fertilisants
organiques peuvent causer des dommages environnementaux. C'est
le cas des lisiers de porcs (le Québec
en produit des quantités astronomiques!). Ces lisiers sont
d'excellents fertilisants (très riches en azote), mais
ils contiennent peu de matière végétale.
Ils ne reconstituent donc pas l'humus du sol. Puisqu'ils sont
liquides, on peut en épandre de grandes quantités.
Cependant, surtout si le sol est pauvre en humus, ils peuvent
facilement être lessivés vers les nappes phréatiques
(nappes d'eau souterraines) ou vers les cours d'eau environnants.
Un épandange excessif de lisier peut polluer les cours
d'eau environnants ou les eaux souterraines.
|
Pour
produire une tonne de grains de blé, le sol perd
:
- 18,
2 Kg N
- 3,6
Kg P
- 4,1
Kg K
|

|
|
Engrais
chimiques
Les
engrais chimiques sont faits d'éléments minéraux
directement assimilables par les plantes. Ils ont de nombreux
avantages pour l'agriculteur:
- On
peut en modifier la composition selon le sol cultivé
et les besoins spécifiques des plantes cultivées.
- On
peut en épandre de grandes quantités (pas trop
quand même, au-delà d'une certaine dose, ça
ne donne plus rien d'en ajouter; ils peuvent même rendre
le sol hypertonique).
- Ils
sont faciles à manipuler et à entreposer.
Mais
ils peuvent être dommageables à long terme:
- Ils
ne reconstituent pas l'humus (la part organique)
des sols puisqu'ils sont faits de matière inorganique.
- Ils
sont donc peu favorables à la vie des organismes
vivants du sol.
- Leur
production est coûteuse en énergie (engrais
azotés surtout; voir, plus loin, le procédé
de production de ces engrais).
- Ils
sont appliqués à forte dose quelques fois dans
la saison (l'engrais provenant de l'humus est, lui, libéré
progressivement). Les surplus sont facilement lessivés
vers les cours d'eau environnants plutôt que de profiter
à la croissance des plantes.
L'irrigation
L'agriculture
nécessite beaucoup d'eau surtout en climat chaud et sec.
Cette eau est souvent puisée dans des nappes souterraines
qui peuvent s'épuiser.
Dans
les régions les plus sèches de la planète,
l'irrigation peut entraîner la salinisation
des sols. En effet, lorsqu'on irrigue fréquemment, ce qui
est nécessaire en climat sec, l'eau d'irrigation s'évapore,
mais le sel qu'elle contenait (l'eau n'est jamais pure, elle a
toujours une certaine teneur en sel) demeure dans le sol qui devient
plus salé. Après des années d'irrigation,
le sol peut devenir trop salé pour supporter la croissance
des plantes.
|
Au Québec
où les précipitations sont importantes et
où l'agriculture utilise peu d'eau souterraine, on
ne fait pas face à ce genre de problème. L'eau,
au Québec, est un bel exemple d'une ressource
renouvelable. Une ressource est dite renouvelable
si sa consommation n'excède pas son renouvellement.
Au Québec,
environ 80% de la population s'approvisionne en eau de surface
(fleuve St-laurent, lacs et rivières). Cette eau
de surface doit être traitée par des usines
de filtration afin de la rendre potable. Le coût de
ce traitement varie entre 50 cents et 1$ le 1000 L. Si la
source d'eau est importante (fleuve, rivière, grand
lac), la consommation excessive de cette eau aurait des
conséquences économiques (la facture de taxe
municipale risque de grimper s'il faut augmenter la production
des usines d'épuration), mais pas du tout de conséquences
sur l'environnement. Par contre, il pourrait y avoir problème
au cours des périodes les plus sèches de l'été
si la source d'eau était limitée. Ce serait
le cas, par exemple, d'une mucicipalité dont l'approvisionnement
en eau se ferait à partir d'un petit lac.
Le reste
de la population consomme de l'eau souterraine (nappes phréatiques
profondes ou puits de surface). Cette eau très pure
n'a presque pas besoin de traitement avant d'être
distribuée. L'eau souterraine se renouvelle constamment
à partir de l'eau des précipitations qui s'infiltre
dans le sol. Les quelques études menées sur
le renouvellement de l'eau souterraine ont montré
que le prélèvement humain pour la consommation
est négligeable par rapport au taux de renouvellement.
Actuellement,
il ne semble donc pas y avoir de problème d'épuisement
de la ressource, même là où on puise
de grandes quantités d'eau souterraine. La prudence
est tout de même de mise puisque peu d'études
ont été faites sur la capacité de renouvellement
des eaux souterraines. Évidemment, il faut dire qu'en
matière d'eau, le Québec est une région
particulièrement favorisée par rapport au
reste de la planète.
|
|

|
3/4
des eaux douces consommées au monde sert à
l'agriculture
Aux
USA, 25% des eaux souterraines sont consommées plus
vite qu'elles ne se renouvellent (70% dans certaines régions
du Texas).
En
Californie, 85% de l'eau douce consommée est utilisée
pour l'agriculture.
|
|
©
Gilles Bourbonnais / Cégep de Sainte Foy
|